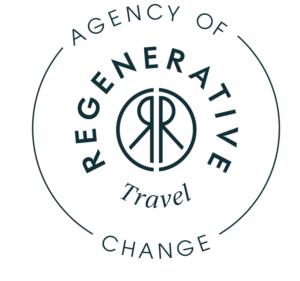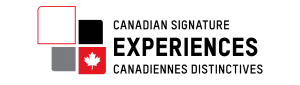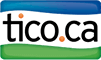Un sanctuaire menacé
Protéger l'habitat du béluga dans l'estuaire du Saint-Laurent

Même de loin, les bélugas imprègnent l’imaginaire. Avec leur corps blanc qui contraste avec les eaux bleues du Saint-Laurent, ils sont faciles à repérer. À travers les troupeaux – une vue encore plus saisissante – les petits à la peau plus foncée rappellent à la fois la fragilité et la résilience de cette population.
Photo: Croisières AML
Photo: Croisières AML
Pour les personnes qui cherchent à vivre une connexion profonde avec la nature, peu d’expériences rivalisent avec l’observation des bélugas dans leur habitat naturel. L’estuaire du Saint-Laurent, situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et du fjord de la rivière Saguenay, au Québec, est l’habitat de près de 2000 bélugas et l’une des meilleures destinations au monde pour observer les baleines.
Même si on a tiré la sonnette d’alarme dès les années 1970, voire avant, la population de béluga est toujours menacée et peine à augmenter. Les voir circuler dans leur habitat est un privilège et un rappel de la fragilité de la population et de son habitat.


Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, créée en 1998, est au cœur des efforts de protection des bélugas. L’aire protégée fait pour l’instant un peu plus de 100 km et permet aux touristes d’observer cet animal fabuleux tout en assurant sa sécurité. Et elle quadruplera, selon une annonce faite par le ministère de l’Environnement du Canada en mars, protégeant encore plus l’habitat.
Photo: GouvQc/Jean FrancoisBergeron Enviro Foto
Photo: GouvQc/Jean FrancoisBergeron Enviro Foto

Contrairement aux autres mammifères marins, qui migrent souvent sur des milliers de kilomètres d’une saison à l’autre, le béluga du Saint-Laurent y passe l’année, quoiqu’une partie de la population préfère s’installer dans le golfe, l’hiver. Sa présence est donc continue, autour de Tadoussac. L’été, le béluga partage l’estuaire avec le rorqual commun, des baleines à bosse et des baleines bleues, ce qui en fait un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines.


"J’ai vu des bélugas ce matin", se réjouit Robert Michaud depuis son bureau de Bergeronnes, baigné par le soleil et qui offre une vue magnifique sur le fleuve. M. Michaud est le directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), qui veille sur cet habitat, les menaces persistent. Depuis 2017, le béluga du Saint-Laurent est en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
"Nos voyants sont toujours au rouge, on est toujours inquiet", souligne-t-il.
Photo: Croisières AML
Photo: Croisières AML
Même s’ils sont interdits depuis des décennies, des contaminants comme les PBDE (des retardateurs de flammes) et les BPC continuent de fragiliser la population de bélugas, notamment dans sa capacité à se reproduire.
Depuis 1982, le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) étudie systématiquement les carcasses échouées. Le taux de mortalité est spectaculaire et inquiète les scientifiques : « À partir de 2010, 60 % des femelles retrouvées étaient mortes de dystocies. Avant, c’était seulement 10 % », rapporte M. Michaud. Ces femelles auraient dû donner naissance à des bélugas, qui auraient déjà eu des petits à leur tour. La population pourrait ainsi connaître un nouveau déclin.
D’autres menaces empêchent le rétablissement de la population. Par exemple, la surpêche et la fonte des glaces limitent l’accès à la nourriture. Les glaces offrent une protection contre le vent et l’agitation de la mer et la nourriture s’y concentre. D’autres dérangements, comme la navigation et le bruit interrompent les activités des bélugas.
À cause de ces menaces, le béluga est devenu un symbole de la fragilité du Saint-Laurent.

Les bélugas sont présents dans le Saint-Laurent depuis plus de 10 000 ans. Les populations autochtones les ont chassés, d’abord, puis les Européens établis dans la vallée du Saint-Laurent ont fait de même, transformant leur graisse en huile et leur peau en cuir.
Au début du 20e siècle, croyant à tort que le béluga avait décimé la population de morue, des mesures draconiennes ont été prises pour réduire la population. Le gouvernement est allé jusqu’à bombarder le Saint-Laurent en 1932 pour parvenir à ses fins.
Dans les années 1970, la population de bélugas du Saint-Laurent était passée de 10 000 à 500 individus, selon les données alors recueillies par Pêches et Océans Canada.
Malgré l'interdiction de la chasse dès 1979, les méthodes de dénombrement semblent indiquer que la population n’a pas connu de croissance.
«La population des bélugas est relativement stable depuis l’arrêt de la chasse », explique M. Michaud. Aujourd’hui, elle serait d’environ 1850 bélugas.
Très peu de temps s’est écoulé entre la fin de la chasse et l’observation du béluga dans son habitat naturel. Dès les années 1980, de premières entreprises se sont installées dans la baie de Tadoussac, attirant les touristes en soif d’émerveillement.

Les bélugas sont présents dans le Saint-Laurent depuis plus de 10 000 ans. Les populations autochtones les ont chassés, d’abord, puis les Européens établis dans la vallée du Saint-Laurent ont fait de même, transformant leur graisse en huile et leur peau en cuir.
Au début du 20e siècle, croyant à tort que le béluga avait décimé la population de morue, des mesures draconiennes ont été prises pour réduire la population. Le gouvernement est allé jusqu’à bombarder le Saint-Laurent en 1932 pour parvenir à ses fins.
Dans les années 1970, la population de bélugas du Saint-Laurent était passée de 10 000 à 500 individus, selon les données alors recueillies par Pêches et Océans Canada.
Malgré l'interdiction de la chasse dès 1979, les méthodes de dénombrement semblent indiquer que la population n’a pas connu de croissance.
«La population des bélugas est relativement stable depuis l’arrêt de la chasse », explique M. Michaud. Aujourd’hui, elle serait d’environ 1850 bélugas.
Très peu de temps s’est écoulé entre la fin de la chasse et l’observation du béluga dans son habitat naturel. Dès les années 1980, de premières entreprises se sont installées dans la baie de Tadoussac, attirant les touristes en soif d’émerveillement.

À Baie Sainte-Catherine, une toute jeune Agathe Poitras côtoyait alors les guides naturalistes. Sur leurs pas, elle a commencé à travailler sur les bateaux d’excursion dans les années 1990. Elle a été témoin de la progression dans les pratiques.
Avant que le parc marin encadre les activités d’observation, "il y en a qui s’en donnaient à cœur joie. Le but, ce n’était pas de leur toucher, mais quasiment ", se souvient-elle.
Elle reconnaît que les gens ont beaucoup plus conscience de l’impact d’une présence sur l’eau. Plusieurs personnes lui demandent si la croisière dérange. Elle en profite pour parler de la vie sous-marine fascinante et de l’écosystème fragile. Elle leur explique : "On va aller tranquillement. On a une vitesse maximale à respecter. Quand on va arriver sur le site, on va ralentir, être prudent dans nos approches."
Elle leur parle aussi de la réglementation. Les bateaux d’excursion doivent se tenir à plus de 400 mètres des bélugas. Certaines zones ne sont carrément pas accessibles : la baie Sainte-Marguerite est un refuge où il est interdit de naviguer, de juin à septembre. Le nombre d’embarcations et le temps passé dans certaines zones sont aussi limités.
Des exploitants comme Croisières AML où travaille Mme Poitras, font partie de l’alliance Éco-baleine, fondée en 2010 pour promouvoir des pratiques d’observation des mammifères marins écoresponsables.
"C’est plus du tout le même genre de voyage. Avant, ce qu’on voulait c’était être impressionné. Puis là, on part plus pour explorer, pour profiter de la nature. "
Photo: Croisières AML
Photo: Croisières AML
M. Michaud souligne aussi l’éventail d’endroits aménagés pour bien observer les mammifères marins à partir de la côte. Par exemple, les plateformes du Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) de Tadoussac, où il travaille.
En plus, le CIMM regroupe la plus grande collection de squelettes de baleines au Canada. Sur place, des naturalistes répondent aux questions du public.
Il chérit particulièrement la retransmission par drones et hydrophones. « On réalise à quel point ils sont toujours en interaction. » Il souhaite que le public comprenne à quel point les bélugas ont une vie sociale riche et complexe, qu’ils sont vulnérables, "et à quel point on est chanceux de partager Saint-Laurent avec eux. "
Photo: Cote-Nord GouvQc/Cecile Benoit
Photo: Cote-Nord GouvQc/Cecile Benoit
Comme touriste, ça signifie aussi qu’il faut accepter le caractère imprévisible de la nature, mesurer le privilège d’observer ces animaux fabuleux et faire sa part pour protéger l’estuaire du Saint-Laurent et ses populations marines.
Andréanne Joly
Andréanne Joly aime explorer et faire découvrir les francophonies canadiennes et leurs espaces touristiques. Par leur richesse, leur beauté, leur diversité et leur accessibilité, les destinations canadiennes ne cessent de l'épater. Journaliste et rédactrice depuis longtemps, ses reportages lui ont valu plusieurs prix d'excellence. Elle collabore avec Affaires universitaires, l’Alliance du tourisme culinaire, L'Express de Toronto, Francopresse.ca, ICI Radio-Canada, NorddelOntario.ca, TFO et Le Voyageur de Sudbury.

Canada. Crafted by Canadians.